..this is in no way a value-loaded statement but a (very simplistic) paraphrasing of Nancy Huston's work 'L'Espèce Fabulatrice.' One blog-reader returns to this book to unwind what Huston means when she talks about how we make our own meaning out of reality..
(for the English version just scroll down)
Le fait est que nous avons tendance à « fabuler » dans la plupart des circonstances : spontanément ou par un long détour, nous mettons au point de petits arrangements avec la réalité.
Il faudrait s’entendre sur ce que recouvre cette action de « fabuler ». Fabuler, c’est bien-sûr, raconter une histoire ; c’est plus largement en passer par le discours – quelle que soit la forme qu’il prenne – pour interpréter, appréhender, signifier, exprimer, comprendre. L’écueil majeur ici est que dans un sens aussi large fabuler soit affecté d’une ombre, d’une signification négative. Si l’on fabulait sans cesse, on ne serait jamais dans la réalité.
Précisément. Telle est la réalité humaine. Le « réel-réel », la réalité brute compte en vérité pour bien peu. En général, prétexte à autre chose ou matière à interprétation. Alors, nous fabulons. Mais ce n’est pas pour autant de l’air, ce n’est pas du rien : c’est au contraire l’une des manifestations de l’essence même de l’humanité.
Nancy Huston indique trois registres dans lesquels son observation est corroborée :
- A l’échelle de l’espèce, la fiction est un stratagème ou une ruse archaïque visant sa survie et sa perpétuation.
- A l’échelle de l’individu, la fiction est une tendance innée, un mécanisme du cerveau, tout autant qu’une structure de la représentation ou de la conscience.
- A l’échelle sociale, la fiction est un dénominateur commun à tous les groupes humains.
C’est bien toute la réalité humaine que la romancière drape dans l’idée de fiction. Une dernière retouche lui permet de rappeler la contingence radicale du monde : sa justification sur un plan métaphysique ou plus simplement sa signification , ne préexiste pas à l’action humaine : « L’Univers comme tel n’a pas de Sens. Il est silence. Personne n’a mis du Sens dans le monde, personne d’autre que nous. » ( L’espèce fabulatrice p.15). Plus loin : « Le réel est sans nom. » ( idem p.18).
Quel bénéfice y a-t-il à baptiser fable ou fiction toute la réalité humaine, ou la réalité telle que nous l’appréhendons ? A quoi bon mettre au jour le coefficient d’irréalité que porte le langage humain dès lors qu’il s’accomplit en récit ou en histoire ?
Quelques éléments pour nourrir le questionnement :
« […] nous avons besoin que [du] sens se déploie – et ce qui le fait se déployer, ce n’est pas le langage mais le récit. » ( p.16 ).
« Parler ce n’est pas seulement nommer, rendre compte du réel ; c’est aussi toujours, le façonner, l’interpréter et l’inventer. » ( p.18).
in English:
"The fact is that in most cases we tend to ‘make up stories’, either spontaneously or taking a long detour as we do it, we organise our own interpretations of reality
It’s important to be clear on what we mean by this ‘story-telling’. Of course we mean ‘telling a story’, in a wide sense it means working out a personal argument or presentation of sorts – to interpret, make sense of, signify or express. The main trap here is that story-telling is always affected by a shadow, or negative meaning. If we tell stories all the time then we lose contact with reality.
Which brings us to the most important point; - such is the nature of human ‘reality’. ‘True-reality’ or the ‘raw-truth’ in fact counts for very little and in general is but a pretext or material for yet more ‘fabulation.’ And so we go on making up our stories. However having said this, our tendency to ‘fabulation’ around reality is not mere air or nothingness. On the contrary, it is one of the essentials outward signs of human nature itself.
Nancy Huston points out three levels at which she observes this activity :
- for the human species, fiction is a strategy or archaic ruse aimed at self-perpetuation and survival.
- where the individual is concerned fiction is an innate tendency a brain mechanism as much as a structure to do with imaging or consciousness.
- on the social level, fiction is a common denominater in all human groups
The novelist includes the whole of human reality in her concept of fiction. A final adjustment enables her to recall the radically contingent nature of the world: its justification on a metaphysical level or more simply its meaning does not pre-exist human action itself,
“The universe as such has no Meaning. It is silence. Nobody ever put Meaning into the world, noone that is except us” (p15) Further on “reality is nameless.” (p18)
What use is there in baptising ‘fable’ or ‘fiction’ all of human reality, or even reality such as we understand it? What is the point in updating ‘the unreality index’ inherent in human language as it accomplishes itself in story or recital?
Finally, a few more quotations to take us further on the subject:
“(…)our only need it that meaning opens out and applies itself – and what makes it open out thus is not language itself but story-telling” (p16)
“Talking is not only naming, or recounting reality, it’s also the manipulation, interpretation and invention of this very reality.”
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
























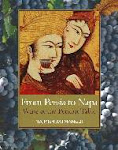






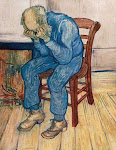



















Je ne parle pas anglais, mais à propos des "petits arrangements avec la réalité"...: L’instabilité est la mère nourricière par où l’enfant dort profondément, par où ses rêves l’abîment comme une peau qu’il tient pour sienne, un inconscient qui lui sied à merveille tant qu’il ne grandit pas, qui le sert et lui sert de protection contre lui-même. L’homme habillé de cette mémoire rongée sent combien lui pèse maintenant un tel accoutrement et pour s’en défaire s’abîmera toujours tant qu’il ne l’aura pas assimilé à son propre épiderme. Cette peau, qu’il a pourtant choisi de confondre à sa surface, reste un trop malsain et nuisible; s’y accumule un tas de désillusions et de bonheurs avortés. Comment pourrait-il comprendre cette réalité qui mue en lui et sur lui, qui n’a de cesse de se renouveler et de le desservir? Les aurores de sa vie coulent en son sein sans qu’il puisse en saisir la moindre lumière, et c’est de ce néant oblongue et charrié que dépendront ses jours…, et son passé.
ReplyDeleteLa plupart des philosophies ont en commun de proposer un ordre parmi les facultés humaines. Sensibilité, perception, imagination, entendement, raison, tour à tour, l’une ou l’autre, selon le propos du penseur, fondera l’une d’elles voire toutes les autres. Dans les pensées les plus rationalistes, l’imagination fait souvent figure de trouble-fête ou de parent pauvre. Très novateur, Gaston Bachelard tenait la rêverie pour un état subjectif fondamental et il plaçait l’image avant la pensée et avant même le récit.
ReplyDeleteS’il avait été métaphysicien, Bachelard eût inauguré, selon ses propres termes, une « révolution copernicienne de l’imagination » en considérant que ce que nous imaginons s’explique moins par une référence (ou une ressemblance) avec l’objet réel que par une signification de part en part subjective. Ainsi, comme il l’écrivait, le rêve précéderait la réalité, le cauchemar le drame, la terreur le monstre, et la nausée la chute. [L’air et les songes, chapitre 3].
Dans L’espèce fabulatrice, c’est le récit que Nancy Huston place au centre. Son texte fait écho, à mon sens, aux préoccupations de Gaston Bachelard et ses passages les plus méditatifs entrent en résonance avec les intuitions du promeneur-philosophe. Je pense à l’avant-propos de La Psychanalyse du feu : « Il suffit que nous parlions d’un objet pour nous croire objectifs. Mais par notre premier choix, l’objet nous désigne plus que nous ne le désignons et ce que nous croyons nos pensées fondamentales sur le monde sont souvent des confidences sur la jeunesse de notre esprit. » . Un peu plus loin : « Toute objectivité, dûment vérifiée, dément le premier contact avec l’objet. Elle doit d’abord tout critiquer : la sensation, le sens commun, la pratique même la plus constante, l’étymologie enfin, car le verbe, qui est fait pour chanter et séduire, rencontre rarement la pensée. »
L’objectivité donc, ne s’obtient qu’après un patient détour, presque une ascèse. « Nos pensées fondamentales sur le monde », loin de porter le signe univoque du réalisme ou d’une lecture particulièrement sagace du réel sont d’abord empreintes de subjectivité… ourlées de fiction, dirait Nancy Huston…d’imaginaire s’accorderaient-ils à penser.
« Nos pensées fondamentales sur le monde » : c’est sur elles que Nancy Huston invite à nous pencher avec soin. Saurons-nous apercevoir ce qu’elles contiennent d’hypothétique et de fictif ? Serions-nous prêts à en changer, à faire varier nos points de vue, à accorder à ces pensées une importance relative ?
Mais comment appréhender ce caractère fondamental de nos pensées et par là repérer ce qui nous porte à leur conférer cette importance ?