..an act of self-nourishment. In this last instalment from her reading of Nancy Huston's book, 'L'Espece Fabulatrice' blog-author 'A' explains Huston's belief that fiction contains a spirtual substance and ultimately a true civilising' force at the opposite extreme of those destructive illusions leading ultimately to war and the 'dismemberment' of human societies.
(as usual, scroll down to read in English)
'Il arrive que l’on puisse tirer parti d’un vent contraire. Ainsi, alors que la vie ne pouvait plus s’épanouir normalement, hors les murs du logis familial, puisque tout le pays –l’Iran- s’est trouvé plongé dans l’adversité d’une révolution mensongère et d’une guerre interminable, un ami me confiait qu’il avait saisi là l’opportunité de prodiguer à ses enfants une éducation selon ses vœux. Les arts y tenaient une grande place. Et il ajoutait qu’en toutes circonstances, ses meilleurs amis restaient les livres et la musique. Ses paroles étaient sans amertume ni malice. Son regard avait l’éclat d’une joie solide.
Il est étrange que, le plus souvent, nos plaidoyers en faveur de la lecture et des livres passent les mots. Tout se passe comme si l’on éprouvait quelque peine ou quelque remords à mettre nos lectures dans la balance. Face au réel, elles font toujours si peu de poids. Mais certains silences sont éloquents parmi lesquels je compte celui de mon ami iranien. Il est vrai aussi qu’entre lecteurs on peut s’entendre à demi-mots, mimant peu ou prou l’acte de lecture solitaire et silencieux. Pourtant, parfois, il me semble que tout irait mieux en le disant.
C’est pour pallier au silence insensé qui entoure ce livre que je soutiens qu’il est urgent de lire et de faire lire L’espèce fabulatrice. Il est urgent d’en rédiger des traductions, d’en proposer la lecture dans les écoles. Il est essentiel d’écouter ce qu’un auteur contemporain nous dit du roman, de son rôle dans nos vies, dans les sociétés, dans la civilisation. C’est urgent y compris dans une république européenne dont le président vilipende publiquement un roman de l’âge classique, La Princesse de Clèves, pour le motif que son étude au programme d’un concours administratif lui paraît… superflue.
A la fin des entretiens avec Matthieu Galey [Les yeux ouverts], le critique littéraire demande à Marguerite Yourcenar (http://www.dailymotion.com/video/x428t_yourcenar-portrait_school) pourquoi la fiction est le moyen qu’elle a choisi pour transmettre une certaine expérience, un certain regard. Yourcenar répond non sans une subtile ironie : « Vous avouerais-je que je n’ai jamais eu le sentiment d’écrire de la fiction ? ». L’aveu peut ne pas surprendre entièrement si l’on évoque le soubassement historique de la plupart de ses écrits. Mais cette érudite n’est pas exactement auteur de livres d’histoire. Il se trouve que la singulière proximité entretenue avec ses personnages rend simplement impossible ou impensable leur assimilation à des êtres de fiction. Pour l’auteur, ils sont des compagnons de chaque jour.
Ainsi, lorsque la vieille dame malicieuse dit « mais voyons, je n’écris pas de fiction », j’entends à l’autre extrémité d’un invisible lien, Nancy Huston considérer que les romans ont une mission civilisatrice.
Si Marguerite Yourcenar fait l’économie du concept de fiction, c’est afin de souligner cette réalité propre aux personnages de romans. Si Nancy Huston accentue ce même concept, c’est afin d’en faciliter au lecteur l’approche, puis l’appropriation.
Comme en témoigne L’espèce fabulatrice, la réalité humaine est pleine de fictions « involontaires et pauvres », malveillantes et contreproductives. Il importe que l’on puisse en bâtir de riches et de complexes. Il importe que les lecteurs se familiarisent avec ces fictions qui ont la vertu des remèdes, qu’ils s’approprient ces possibilités nouvelles d’existence que l’art du roman sait montrer. Rien de tel que les romans, dit Nancy Huston, pour permettre de retravailler les «fictions identitaires reçues ». Rien de tel que les romans pour agrandir son propre univers, se rendre capable de repérer les fictions néfastes et se libérer de leur emprise.
« Nous avons intérêt à savoir en quoi lire nous fait du bien. » (Page 181).
Il importe d’apprendre à faire de cette substance que contiennent la littérature et surtout les romans, notre aliment privilégié. Un apprentissage et une pratique qui doivent rendre capable de plus d’empathie, qui doivent aider à diffuser la vertu de la sollicitude loin, très loin des dispositifs guerriers, sécuritaires, intolérants qui démembrent les sociétés humaines."
And in English;
Sometimes an ill wind does blow some good. Thus once upon a time when life could nolonger go on as usual outside the family home since the whole country – Iran – was plunged deep in the suffering of betrayed revolution and endless war, a friend confided in me that he had used this very opportunity to provide his children with exactly the sort of education he wished for them. The arts and humanities played a major role in his ideas. He added that whatever the circumstances, books and music always turned out to be his best friends. His words were entirely free of bitterness
or spite and his eyes shone with deep joy as he spoke.
It’s curious how much more than often the best defence of books and reading goes beyond words. As if in some way it hurts or affects us to weigh up what we read. Faced with blunt reality our reading matter pulls so much less weight. Nevertheless, certain silences, including those of my Iranian friend, have their own eloquence.
Readers can often come to mutual understanding through hints and indirect allusion, thus in some way miming that solitary, silent act of reading. Nevertheless, sometimes it seems to me that it would be so much better to put words on the experience.
It’s in order to remedy the scandalous silence surrounding Nancy Huston’s book that I am writing to point out the importance of reading, and having others read The ‘Espece Fabulatrice’ Translations should be made of this book, it should be suggested as reading matter in schools. It’s essential to listen to what a contemporary writer has to tell us about the novel and the role of fiction in our lives, in various societies and in civilisation; and all the more important in a European republic whose president goes out of his way to publicly vilify a classical novel ‘The Princess of Cleves’ pretexting that its presence on the syllabus of a civil service programme strikes him as …unnecessary.
(http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2009/mar/31/princess-cleves-sarkozy-lafayette)
At the end of a series of interviews with Matthieu Galey in ‘les yeux Ouverts’ - in English ‘Eyes wide open,’ the literary critic asks Marguerite Yourcenar why she chose fiction to vehicle a certain type of experience and outlook. Yourcenar’s response is not without its own subtle irony, “May I confess that never once have I had the impression of writing ‘fiction’ “ The confession is not entirely surprising if we consider the historical basis of most of her writing. Yet the learned writer is not exactly a ‘historical’ novelist. It so happens that the unique closeness she maintains with her characters simply makes it impossible or unthinkable to assimilate them to fictional beings. Where Yourcenar is concerned they are her everyday living companions.
So in the malicious old lady’s reply ‘come, come I don’t write fiction’ I hear Nancy Huston, as at the other extreme of an invisible link, holding out the civilising mission of all novels. If Marguerite Yourcenar is so keen to cut back on the concept of fiction in her work, she does so in order to insist upon the sort of reality peculiar to characters in novels. Nancy Huston on the other hand, accentuates the same concept so as to facilitate the reader’s approach and appropriation of that very idea.
As is borne out in the ‘Espèce Fabulatrice’, human reality is full of ‘poor, involuntary fiction’, which is both malevolent and counter-productive. What’s important is our capacity to fabricate rich and complex fiction out of this substance. It’s equally important that readers should familiarise themselves with those fictions that act as remedies, that they appropriate those new possibilities of living that the art of the novel knows so well how to show us. There is nothing like novels, says Nancy Huston, to help us work out the “received notions” of our own “identity fictions.” There is nothing like a novel for enlarging one’s own universe, for allowing us to take note of our own more dangerous ‘fictions’ and finally freeing ourselves of their illusory hold on us.
‘we would do well to know how exactly reading does us good’ (p181)
The key question is how to make of this special substance in literature and especially in novels, our main source of nutrition. This should involve a learning process and practice that will render us more capable of empathy, which will help us to diffuse solicitousness as a virtue in itself, far, very far indeed from the machinery of war and security systems with all their intolerance and dismemberment of human societies.
Wednesday, April 1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
























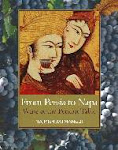






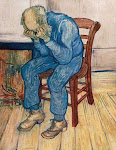



















J'entends une voix engagée, un ton fort et clair - (excuse mes erreurs en
ReplyDeletefrançais!) Very inspirational. N H comme nous l'appelons, - (ca fait un peu
Kafkaesque) est très optimiste n'est-ce pas. C'est optimiste de formuler
l'idée si évidente mais pas du tout à la mode dans un climat commercial -
que l'activité de lire appartient à une sorte de pouvoir silencieux, vitale
et résistant . La preuve, bien-sûr les autos-da fé de l'histoire..enfin
c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. La suprematie de
'la fiction' sur tout autre forme de débat/ raisonnement m'a frappée ce
week-end au cinéma quand on est allée voir 'Welcome' - c'est un film qui
raconte le sort des refugees politiques /ou autre 'clandestin' à leur
arrivée en Europe..dans ce film on est tout de suite dans la peau du refugee
qui se trouve en France et qui rêve de traverser le Manche pour regagner
l'Angleterre..c'est très emouvant. On a beaucoup pleuré. Peut-être une sorte
de 'catharsis' devant le spectacle tragique?
Et voilà une question que j'aimerais poser et developper sur le blog -
comment peut-on équilibrer le poids du 'visuel'/de l'écran aujourd'hui face
à la page écrite - est-ce vraiment un problème - ou pas - qu'on s'alimente
plus par l'image que par le mot....
Le VIIème chapitre de L'espèce fabulatrice est consacré aux "fables guerrières". Nancy Huston évoque notamment le génocide qui a eu lieu au Rwanda et qui a commencé il y a exactement 15 ans ces jours-ci.
ReplyDeleteL'auteur rapporte les paroles d'un génocidaire : dans le visage de celui qu'il massacre, il ne reconnaît littéralement plus le camarade avec lequel il jouait au foot quelques jours auparavant. L'assassin se raconte à lui-même que sa victime n'est pas un proche.
Aujourd'hui je voudrais ajouter que ces mauvaises fictions, ces fables avec lesquelles le pire a parfois lieu, pour arbitraires qu'elles paraissent, peuvent avoir une genèse décelable, au moins en partie. Elle se repère dans une succession d'histoires qui, en ce qui concerne le Rwanda, furent investies d'un rôle politique.
Les intervenants des diverses émissions diffusées la semaine dernière par france-culture ont apporté un éclairage précieux sur le génocide et sur l'histoire récente du Rwanda. D'autant plus précieux que l'accent a pu être mis sur la réalité sociale et politique du pays avant la colonisation par les Européens. Je m'appuie donc ici sur ces interventions écoutées à la radio.
Dès le 7 avril 1994, les journalistes français des radios nationales évoquent un "conflit ethnique" suite à la mort du président rwandais dans la chute de l'avion qui le ramenait à Kigali.
Que signifie ce terme d'"ethnie" ? Il est souvent employé pour désigner, concernant tout particulièrement les pays d'Afrique, des peuples incompréhensiblement distincts car ils partagent une même terre, ont en commun une langue et par là, une culture, des croyances, des coutumes, des habitudes de vie. Tutsi et Hutu seraient alors les noms de deux "ethnies"... rwandaises. Or, il se trouve qu'avant la colonisation, ces mêmes noms désignaient non pas deux peuples comme on persiste à le croire, mais équivalaient à des catégories socio-professionnelles et à des rôles politiques. Stables, ces distinctions étaient aussi perméables. Des évènements ou des décisions pouvaient provoquer un changement de groupe.
On peut alors mesurer à quel point le terme d'"ethnie" est ici impropre. Il ressort des connaissances historiques actuelles que les colonisateurs venus d'Europe ont à la fois méconnu et évalué faussement les distinctions qui couraient dans la société rwandaise. Très vite, ils ont investi les hiérarchies sociales de critères "ethniques", c'est-à-dire raciaux, qui étaient en vogue au début du XXème siècle chez les ethnologues, puis -et pour le pire- chez les politiques. Dès 1931, au Rwanda, la carte d'identité mentionne l'appartenance à telle ou telle "ethnie". Autant dire que l'Etat colonial a entrepris de fonder en nature les distinctions sociales existantes.
Dans un premier temps, l'administration belge favorise les Tutsis qui, depuis longtemps, occupent dans la société rwandaise des postes de commandement. Ils deviennent un relais de l'autorité du colonisateur et une élite qui accède aux études supérieures. La fin de la IIème guerre mondiale correspond à la montée des revendications indépendantistes au sein de l'élite rwandaise, tutsie en l'occurence. En réaction, les colonisateurs estiment qu'un rééquilibrage des forces doit avoir lieu, en faveur des Hutus (majoritaires par le nombre). Alors, la doctrine des critères raciaux étendue à la société rwandaise se voit augmentée d'une "théorie" à valeur de mythe : celle de l'origine géographique de préférence lointaine des Tutsis. Ce qui revient à les stigmatiser comme étrangers à leur propre pays. Et puisque, depuis longtemps, ils occupent un rang élevé dans la société, on ne tarderait pas à les voir comme des usurpateurs. A la fin des années 50, l'incompatibilité teintée de ressentiment et de haine entre "ethnies" est avérée et un "Manifeste hutu" est publié, qui formule la possibilité d'une violence de masse...
Il n'y aurait guère de sens à présenter la société rwandaise pré-coloniale comme un âge d'or. Mais simplifier, ou passer sous silence la responsabilité de la politique coloniale et de ses représentants est inacceptable. Si l'éden est peu crédible, l'enfer a bien eu lieu en 1994.
Alors, je voudrais revenir sur les tout premiers rapports des explorateurs occidentaux qui sont arrivés au Rwanda dans les années 1890. Ces explorateurs évoquaient leur étonnement quand ils découvrirent au sein d'une jungle qui leur semblait hostile, des hommes s'en accommodant. Des hommes... un peuple qui avait élaboré une organisation politique complexe, comportant une cour très structurée, à la fois centralisatrice et ménageant des autonomies locales. L'organisation militaire en faisait un pays craint dans la région.
Premier mythe, première trahison : cet étonnement des aventuriers venus d'Europe. Qu'espéraient-ils donc trouver ? Des hommes ravalés au rang de bêtes, tant cette nature leur paraissait peu accueillante ? C'est à pleurer. Les Européens ont bien rencontré un peuple doté d'une culture et d'une histoire. Sans doute cette société rwandaise imaginait-elle aussi un destin. Mais celui-ci allait lui échapper radicalement.
Bien des années plus tard, lors d'un discours prononcé à Dakar par le chef d'un vieux pays colonisateur, on retrouvera ce même vieux fantasme d'une nature hostile ou harmonieuse, peu importe, au coeur de laquelle il serait bien improbable, bien étonnant, qu'on découvre quelque chose comme de la culture ou de l'histoire...